Le dimanche 29 mai 2005, au terme d'un débat démocratique d'une exceptionnelle vitalité, le peuple français rejette à une écrasante majorité (55%) le traité constitutionnel européen, pourtant encensé par la quasi-totalité des médias et de la classe dirigeante. Le 2 juin suivant, le peuple hollandais rejette à son tour le traité.
Il s'ensuit aussitôt une « révolte des élites » et un déferlement de colère, voire de haine, à l'égard des classes populaires considérées comme responsables de cet échec du fait de leur étroitesse d'esprit. On commence dès lors à dénoncer sous le nom de « populisme » toute forme de contestation du courant politique central, néolibéral, européiste, mondialiste. La ligne de fracture se retrouve aussi bien à droite qu'à gauche. C'est une rupture par rapport aux décennies antérieures, quand tous les grands partis transcendaient les classes sociales.
Nicolas Sarkozy, élu président deux ans plus tard, va contourner le référendum : avec l'assentiment des élus tant de droite que de gauche, il fait adopter le texte de 2005 sous le nom de traité de Lisbonne. Beaucoup de citoyens, dès lors, boudent les élections, jugeant que leur bulletin ne vaut rien...
Un projet venu du sommet
Le traité constitutionnel européen a été rédigé par une centaine de personnes choisies par leurs pairs (gouvernants, hauts fonctionnaires, parlementaires européens ou nationaux...), sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing.
Cette « Convention » a pris acte de l'échec des sommets européens d'Amsterdam (1997) et de Nice (2001) et s'est donnée pour objectif : 1) rétablir l'équilibre des pouvoirs entre grands et petits États membres, 2) simplifier les processus de prise de décision, 3) doter l'Union d'une véritable politique étrangère et de défense, 4) relancer la symbolique européenne.
Son texte a été paraphé le 29 octobre 2004 par les ministres des Affaires étrangères des 25 États membres et des candidats, y compris la Turquie (page 165 du texte : Türkiye Cumhuriyeti Adina, « Pour la République turque »). Il était prévu qu'il entre en application le 1er novembre 2006 dès lors qu'il aurait été ratifié par tous les États membres.
Les promoteurs du traité ne doutaient donc pas de son acceptation par les citoyens français, au vu des premiers sondages (60% d'avis favorables). D'ailleurs, les Espagnols eux-mêmes l'avaient peu avant accepté à une très confortable majorité quoiqu'une majorité se soient abstenus.
Du doute au rejet
Mais le doute s'insinue dans l'opinion après une saillie de l'ancien Premier ministre socialiste Laurent Fabius. À la surprise générale, il se prononce pour le Non sur un plateau télévisé.
Le débat monte en intensité et les sceptiques s'arrachent l'édition de poche du traité. Plus de 200 000 exemplaires sont vendus malgré le caractère on ne peut plus aride de ses 300 pages.
Les partisans du traité prêtent à leurs adversaires la « peur du plombier polonais » (l'expression est inventée par le commissaire européen Frits Bolkestein, à l'origine d'une directive contestée sur les travailleurs détachés). Ils leur reprochent aussi l'absence de « plan B » en cas de rejet du texte. Ils bénéficient du soutien des classes supérieures et moyennes supérieures ainsi que des personnes âgées qui voient dans la construction européenne une garantie de paix quelle que soit la direction qu'elle prenne.
À la suite de Laurent Fabius, l'extrême gauche dénonce quant à elle un traité qui multiplie les échelons décisionnels dans les instances européennes au détriment de la démocratie et surtout grave dans le marbre le principe ultralibéral selon lequel le bien-être commun reposerait sur une « concurrence libre et non faussée ». De son côté, l'opposition de droite au traité s'indigne de la volonté des instances européennes de faire entrer la Turquie islamiste d'Erdogan dans l'Union européenne.
C'est la conjugaison de ces deux courants qui va faire basculer la majorité.
Quinze jours avant le scrutin, Nicolas Sarkozy, chef de file de la droite européiste, tient un meeting au Palais des Sports de la porte de Versailles (Paris) devant une assistance clairsemée, composée majoritairement de sages retraités aux cheveux gris. Mais une semaine plus tard, dans le Palais des Sports archi-bondé, au milieu d'une foule jeune et déchaînée, Philippe de Villiers, chef de file de la droite souverainiste, dénonce le traité et, avec lui, le projet de faire entrer la Turquie dans l'Union. Il fait acclamer à qui mieux mieux le drapeau arménien, rappel du génocide commis par les Turcs.
Le résultat du scrutin consterne la classe politique et médiatique qui croit y voir la victoire de l'ignorance et du populisme (les hommes politiques qualifient de « populiste » tout mouvement qui leur est opposé et bénéficie, au contraire d'eux, de la faveur de l'opinion).
Mais ce résultat n'exprime pas seulement un désaveu de la politique européenne menée depuis le traité de Maastricht. Il traduit aussi une rupture profonde entre les classes populaires et les classes supérieures. Soucieux de solidarité plus que d’ouverture sur l’Europe, sur l’Autre et sur le Monde, les ouvriers et employés ont en effet voté Non respectivement à 74% et 62% contre 38% pour les cadres supérieures et les professions libérales ! Un abîme sépare les deux catégories sociales. Le philosophe Marcel Gauchet confirmera cette observation : « 2005 restera sans doute la base du basculement. À partir de là, la cassure entre la base et le sommet devient le cœur de la vie publique » (Comprendre le malheur français, 2016). Ce diagnostic va se confirmer dans les échéances présidentielles suivantes.
En attendant, le président de la République Jacques Chirac, gravement désavoué, écarte avec désinvolture toute idée de démission, se démarquant en cela de son augustre prédécesseur, le général de Gaulle. Il exclut également une dissolution de l'Assemblée nationale dont les membres avaient pourtant approuvé à 90% le projet de traité constitutionnel et sont donc désavoués par leurs électeurs.
Après le vote également négatif des Néerlandais, les autres gouvernements de l'Union, y compris le gouvernement britannique, annulent les projets similaires de référendum. Déjà s'organise la riposte.
Contre-offensive de la classe dirigeante
Il ne faudra que deux ans aux dirigeants français et européens pour remettre le traité en selle, avec le soutien des médias.
Le Conseil européen de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007 adopte en catimini un nouveau texte. Sous le nom de « traité modificatif », il est ratifié à Lisbonne, le 13 décembre 2007, par les dirigeants des vingt-sept États membres de l'Union, lesquels se gardent de prendre à nouveau l'avis de leurs concitoyens.
Le traité de Lisbonne comporte plusieurs centaines de pages avec 359 modifications des traités existants, treize protocoles et quelques dizaines de projets de déclarations ayant la même valeur juridique que les traités. Il apparaît dans la forme très différent du projet constitutionnel mais en conserve l'essence. Ainsi en a-t-on retiré les aspects symboliques comme la référence à une quelconque Constitution et à un hymne et un drapeau européens ! Curieusement, les drapeaux étoilés à fond bleu qui ornent nos édifices publics n'ont plus désormais de légitimité ! La formule critiquée de « concurrence libre et non faussée » n'est plus mentionnée que dans un protocole annexe. Les articles du Titre III du projet initial, redondants avec des textes antérieurs, sont aussi éliminés pour la forme.
Autant de détails qui font dire au président français Nicolas Sarkozy que le nouveau texte n'est plus qu'un « un traité simplifié, limité aux questions institutionnelles ». Avec plus de franchise, la chancelière Angela Merkel se félicite qu'il reprenne intégralement le projet constitutionnel.
Là-dessus, le président de la République française réunit les parlementaires en Congrès à Versailles le 4 février 2008 pour modifier la Constitution française et permettre la ratification du nouveau traité par le Sénat et l’Assemblée nationale, sans consulter les citoyens.
Depuis ce tour de passe-passe, les grandes orientations politiques, au niveau national et plus encore européen, échappent aux citoyens. Le système électoral tourne à vide, sans plus aucune chance d'influer sur elles. L'abstention et le vote « eurosceptique » deviennent largement majoritaires comme lors des élections de 2014 au Parlement de Strasbourg. Des penseurs évoquent l'entrée de l'Europe dans une ère post-démocratique.
Deux décennies plus tard, l'état de l'Union européenne confirme les appréhensions des nonistes français et néerlandais. En application depuis 2009 sous la forme du traité de Lisbonne, le traité constitutionnel n'a apporté aucune amélioration au fonctionnement des institutions. Bien au contraire, « il a accentué les travers de la construction européenne, » constate l'ancien Premier ministre Édouard Balladur, qui a fait voter le traité de Maastricht. Dans un libelle du cercle de réflexion Fondapol (L'Europe est notre souveraineté, Fondapol, 2023), il se montre très critique sur l'évolution de l'Union européenne et l'autonomie de plus en plus grande de la Commission : « L’indépendance du président de la Commission européenne à l’égard des États membres est renforcée, puisqu’il n’est plus désigné à l’unanimité mais à la majorité et investi par le Parlement européen ; la Commission, qui dispose du monopole de l’initiative législative, est responsable devant le Parlement qui peut la censurer ; sa composition est réduite, chaque État membre ne désignant qu’un commissaire alors qu’auparavant les plus importants et les plus peuplés en désignaient deux. Quant au rôle du Conseil européen, il est réduit le plus souvent à une approbation a posteriori des décisions prises par d’autres. »
En matière diplomatique règne la plus grande cacophonie et personne ne connaît même plus le nom du Haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères institué par le traité ! En matière intérieure, les tensions et les divergences sont plus vives que jamais. Il n'y a que dans le domaine monétaire où les instances européennes arrivent encore à de laborieux compromis pour sauver la monnaie unique.
Signe des temps, on peut lire dans Le Monde du 18 mars 2015 (page 24) un constat d'échec du projet européen d'autant plus significatif qu'il vient de l'un des partisans les plus engagés de l'euro et du projet constitutionnel, le journaliste Arnaud Leparmentier.
Celui-ci constate que le couple franco-allemand ne fonctionne plus. L'Europe a désormais une seule tête, la chancelière allemande. Et c'est à Berlin qu'aboutissent tous les dossiers sensibles. L'Union européenne et plus sûrement la zone euro ressemblent à une Grande Allemagne. La chute du mur de Berlin n'a pas entraîné la fin de l'Histoire et des nations mais au contraire un regain de nationalisme en Europe, avec « un pullulement de micro-États qui la font plus ressembler à l'Empire austro-hongrois qu'à l'Europe des Six, où le petit jeu est de contester le pouvoir central (Berlin-Francfort-Bruxelles). » Autre désillusion : l'Europe n'est plus un jeu gagnant-gagnant et cela se voit tout particulièrement dans la zone euro, où l'activité fuit les pays les plus fragiles en direction du coeur allemand.
Objectivement, « l'Europe est dominée par l'Allemagne, dans une union monétaire qui la favorise ». Et le journaliste de constater avec amertume que le traité constitutionnel, converti en traité de Lisbonne, n'a pas tenu ses promesses, donnant raison en définitive aux citoyens contre les médias et la classe politique.




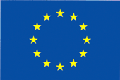

 référendum sur la Constitution
référendum sur la Constitution









Vos réactions à cet article
Recommander cet article
Voir les 10 commentaires sur cet article
Rémy Volpi (29-05-2023 10:06:18)
Ce rejet du traité constitutionnel, qui vient écho au niet du parlement français, en août 1954, à la signature de la Communauté Européenne de Défense proposée en 1952 par le Français René P... Lire la suite
Michel J. (28-05-2023 19:54:16)
A propos des drapeaux : Pourquoi laisser flotter (depuis 2015 ?) en permanence les drapeaux au pavois des édifices publics alors qu’avant ils flottaient seulement les jours de réjouissance populai... Lire la suite
Benito (30-10-2020 10:38:13)
Par contre, je ne comprends pas pourquoi Marine Lepen n'intervient pas dans ce reportage. Si nous parlons de défense de démocratie, il est impensable qu'elle ne soit pas représentée, en tant que p... Lire la suite